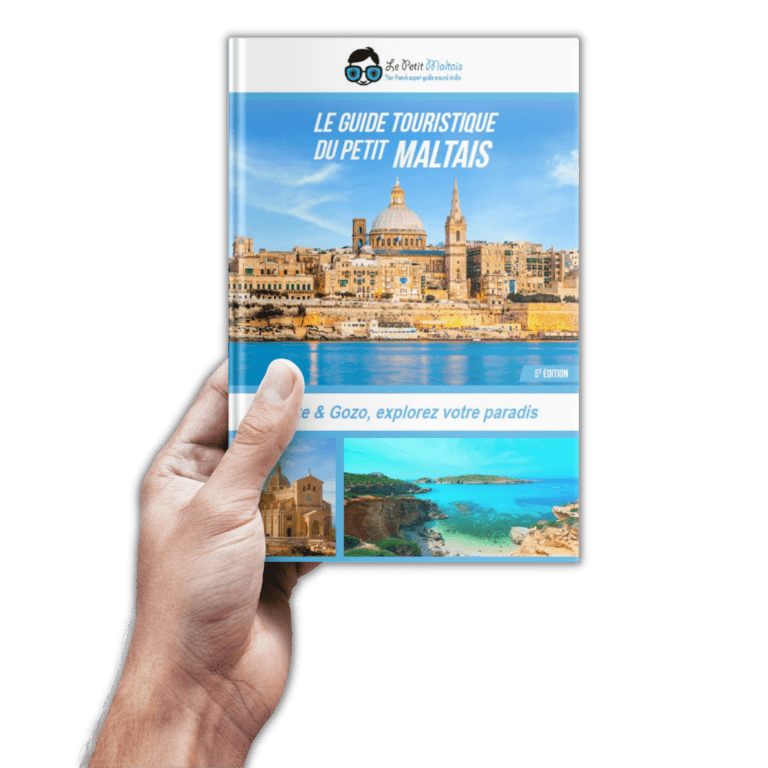Avec ses faibles 550 millimètres de précipitations par an, essentiellement d’octobre à février, Malte est une destination qui réjouit par son ciel bleu toute l’année et ça peut poser problème. Son climat méditerranéen semi-aride signifie l’absence quasi-totale de pluie de mai à septembre. Seulement voilà, sur l’archipel maltais, il n’existe ni rivière ni source d’eau naturelle importante. Répondons à vos questions sur l’eau à Malte. Si l’eau de Malte, Gozo ou Comino est potable et quelle eau vous pouvez boire sur l’archipel. Depuis le néolithique à nos jours, comment les habitants de Malte et Gozo gèrent-ils le défi de l’eau ?
L’eau du robinet à Malte est-elle potable ?
Oui, l’eau du robinet à Malte est considérée comme potable selon les normes internationales de qualité de l’eau. Cela signifie qu’elle est traitée et désinfectée pour éliminer les bactéries et autres contaminants, la rendant sûre à boire.
Cependant, beaucoup de résidents et de visiteurs préfèrent boire de l’eau en bouteille en raison du goût de l’eau du robinet, qui peut être affecté par les processus de dessalement et de traitement. La qualité de l’eau peut aussi varier légèrement en fonction de l’endroit où vous vous trouvez à Malte. Il est toujours conseillé de vérifier les avis locaux si vous avez des préoccupations spécifiques, ou d’opter pour de l’eau en bouteille si vous avez une sensibilité particulière ou pour une meilleure saveur.
L’eau du robinet à Gozo est-elle potable ?
Oui, l’eau du robinet à Gozo est potable, conformément aux standards internationaux. Néanmoins, beaucoup choisissent l’eau en bouteille pour son goût, malgré la sécurité de l’eau traitée.
D’où vient l’eau potable à Malte ?
L’eau potable à Malte provient principalement de deux sources : les aquifères souterrains et le processus de dessalement de l’eau de mer. Étant donné la taille réduite de l’archipel et le manque de rivières ou de lacs naturels, ces sources sont vitales pour répondre aux besoins en eau de la population et des touristes.
- Aquifères souterrains : Une portion de l’eau potable est extraite des aquifères souterrains de l’île. Cependant, la surutilisation et la pollution ont parfois affecté la qualité de cette eau, rendant nécessaire son traitement avant distribution.
- Dessalement de l’eau de mer : Face à la limitation des ressources en eau douce, Malte a investi dans la technologie de dessalement pour convertir l’eau de mer en eau potable. Cette méthode utilise des procédés comme l’osmose inverse pour éliminer le sel et d’autres impuretés de l’eau de mer, produisant une eau potable de haute qualité. Le dessalement fournit aujourd’hui une part significative de l’eau potable de l’île.
Le dessalement est devenu une composante cruciale de l’approvisionnement en eau de Malte, permettant de compléter les ressources en eau naturelles et de garantir une fourniture continue d’eau potable à la population et aux nombreux visiteurs de l’île.
Payez moins cher à Malte

+ de 170 réductions pour les vacances à Malte
Une carte de réductions et des codes promos qu’on a testés pour vous :
L’histoire de la gestion de l’eau à Malte

Lorsque les premiers habitants arrivent de Sicile, ils découvrent une île calcaire, vierge et sans eau. Pour survivre dans un environnement si hostile, ils creusent des citernes dans le sol rocheux de l’archipel pour récupérer et stocker l’eau de pluie, là où l’évaporation est moindre. Car si la pluie tombe en hiver, c’est au printemps et en été qu’elle est essentielle à l’agriculture. Les réservoirs d’eau les plus anciens de Malte sont à découvrir essentiellement près des temples mégalithiques ainsi qu’autour de Dingli.
Plus tard, les Arabes, avec leur bonne connaissance de la gestion de l’eau, introduisent la construction de murets en pierre sèche, la culture en terrasse de plantes peu gourmandes en eau (caroube, olivier, agrumes, coton…) et améliorent les techniques d’irrigation.
L’Aqueduc Wignacourt des Chevaliers

Au fil des siècles, avec l’accroissement naturelle de la population, la technique des citernes ne satisfait plus les besoins des îliens. De plus, cette eau stagnante, souvent souillée, est un énorme vecteur de maladies.
Ayant décidé de bâtir La Valette, les Chevaliers installés à Malte depuis bientôt 100 ans, finissent par trouver l’ingénieur érudit, capable de drainer l’eau des hauteurs du plateau central de Malte et l ‘acheminer par canalisation souterraine, prolongée d’un aqueduc jusqu’à la nouvelle capitale ! Baptisé Aqueduc Wignacourt, ses arches de 1615 sont bien visibles à Santa Venera. En activité jusqu’au 19ème siècle, la médiocre qualité bactériologique de l’eau sera à l’origine d épidémies de choléra…
Par ailleurs, quand vous marchez sur les trottoirs de la Valette, vous verrez partout de grandes grilles au sol : ce sont les ouvertures qui permettaient de récupérer les eaux pluviales dans des réservoirs souterrains, le plus impressionnant : celui de la Casa Rocca Picolla à La Valette.
De petits lacs et barrages sont bien créés durant la période Britannique mais se retrouvent totalement asséchées en été.
La solution venant de la Mer du XX ème siècle

Au 19ᵉ siècle, d’autres méthodes sont expérimentées comme la distillation d’eau de mer en 1881 à Sliema et les forages dans les nappes phréatiques. Avec les avancées scientifiques et technologiques depuis les années 1970, Malte ne connait plus ni pénurie ni coupure d’eau grâce aux trois usines de désalinisation qui utilisent la technique «osmose inversée ». L’eau hautement contrôlée en laboratoire est potable et buvable, bien que son goût ne plaise pas à tous…

La gestion de l’eau reste cruciale pour l’avenir de Malte, car si les citernes ancestrales servent toujours dans les zones agricoles, les forages pompent trop les nappes phréatiques et les toits des nouvelles constructions ne sont pas souvent pourvus de récupérateurs en eaux pluviales.
Pour aller plus loin dans l’organisation de votre voyage, découvrez l’application en ligne Le Petit Maltais. Vous y trouverez la plupart des meilleures visites, sorties, activités et locations autour de Malte avec la possibilité de faire de belles économies :